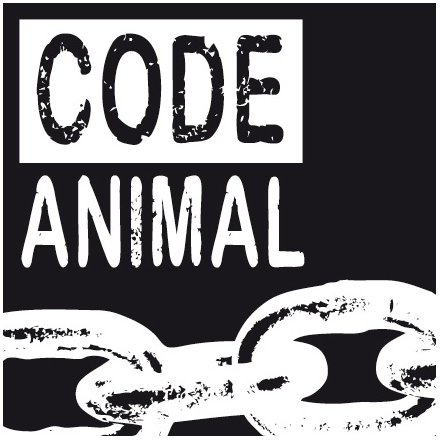Produire un tigre dans une ferme usine ? Ça paraît absurde, et pourtant c’est la réalité de milliers de fermes à travers le monde. Crocodiles, perroquets, serpents, singes… En 20 ans, près d’un milliard d’animaux sauvages ont été produits en captivité pour alimenter le commerce du luxe, de la mode, de la médecine traditionnelle ou du marché des animaux exotiques détenus par les particuliers.
Cela représente plus que la population totale de l’Europe !
Derrière ces murs invisibles pour le grand public, c’est une industrie mondialisée qui prospère dans l’ombre, aux dépens du bien-être animal, de la biodiversité et même de la santé humaine.
Une industrie mondiale et opaque
Une étude internationale récente (Green et al., 2023) a dressé pour la première fois un état des lieux de ce commerce. Entre 2000 et 2020, 487 espèces différentes ont été produites à des fins commerciales dans 90 pays.
- 27 espèces d’amphibiens
- 133 espèces de reptiles
- 249 espèces d’oiseaux
- 79 espèces de mammifères
Au total, près d’un milliard d’animaux sauvages ont été recensés dans ces élevages.
Et encore : il s’agit d’une estimation minimale, car les données sont rares, floues, et souvent volontairement opaques. Autrement dit, la réalité est probablement bien pire.

Source : Unsplash
Des espèces déjà menacées… en cage
Ironie dramatique : 34 % de ces espèces figurent déjà sur la Liste rouge de l’UICN, qui classe les animaux menacés de disparition.
Plutôt que de les protéger, on les enferme dans des cages pour les exploiter comme de simples produits de consommation.
Les défenseurs de ces fermes avancent qu’elles permettraient de réduire la chasse dans les écosystèmes. Mais les faits montrent l’inverse :
- ces fermes servent parfois à « blanchir » des animaux capturés illégalement, en les faisant passer pour des animaux nés en captivité ;
- Leur alimentation nécessite souvent de capturer des individus dans le milieu naturel pour alimenter ou renouveler leurs élevages, ce qui maintient la pression sur les populations sauvages.
Résultat : loin d’être une solution, elles deviennent une menace supplémentaire pour les espèces
Souffrance animale et risques sanitaires
Les fermes d’animaux sauvages ne sont pas seulement un problème éthique abstrait. Elles impliquent, concrètement, des animaux dont les besoins fondamentaux ne sont jamais respectés. Le stress chronique, la promiscuité extrême, l’ennui, les blessures, les maladies, l’automutilation ou encore le cannibalisme en sont les conséquences directes. Ces conditions sont incompatibles avec l’existence même de ces espèces, dont les comportements et besoins sont bien trop complexes pour être reproduits en captivité.
À cette souffrance s’ajoutent des risques sanitaires majeurs. En regroupant des centaines ou des milliers d’animaux sauvages dans des espaces clos, souvent au contact direct d’autres espèces comme les humains, les fermes créent des conditions idéales pour l’émergence et la propagation de maladies infectieuses. La pandémie de Covid-19 l’a tragiquement démontré : en 2020, plusieurs fermes de visons en Europe sont devenues des foyers d’infection, obligeant les autorités à procéder à l’abattage de millions d’animaux.
Le risque ne concerne pas seulement les visons. Crocodiles, singes, civettes ou encore serpents sont élevés dans des systèmes similaires, avec les mêmes conditions de promiscuité et dont les contrôles sanitaires ne semblent pas suffisants. Ces pratiques représentent une véritable bombe à retardement, qui menace fortement la santé publique.

Photo credit : Unsplash
Un leurre pour la conservation
Certains prétendent que l’élevage commercial des animaux sauvages pourrait être une alternative à la chasse ou même une solution pour préserver les espèces menacées. En réalité, c’est une illusion dangereuse :
- il entretient la demande et stimule le marché. L’existence de filières légales rassure les consommateurs et renforce l’idée que consommer des animaux sauvages est normal. En pratique, cela ne réduit pas la pression sur les populations sauvages, mais l’augmente en élargissant le marché.
- Il banalise l’idée que les animaux sauvages sont des « ressources » exploitables. Les espèces deviennent des produits, avec des prix, des catalogues, des codes commerciaux, ce qui brouille complètement la frontière entre vivant et marchandise.
- Il détourne les financements et l’attention de la seule vraie solution : la préservation des habitats naturels. Plutôt que d’investir dans la protection in situ, c’est-à-dire la protection de l’écosystème dans lequel évolue l’animal, l’argent est investi dans le maintien de structures commerciales coûteuses et inefficaces.
En somme, les fermes d’animaux sauvages ne « sauvent » rien. Elles donnent une impression de solution, mais en réalité elles alimentent la consommation, banalisent l’exploitation et affaiblissent les efforts de conservation authentiques. Résultat : loin de protéger la biodiversité, cette industrie accélère son effondrement.
Des lois insuffisantes face à une industrie mondialisée
Ce commerce prospère malgré l’existence d’accords internationaux comme la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), qui encadre le commerce des espèces menacées. Dans la pratique, le manque de contrôles, la corruption et les failles des réglementations nationales permettent à l’industrie de contourner facilement les règles.
Cette situation est en totale contradiction avec les engagements de la France et de l’Union européenne en matière de protection de la biodiversité, de santé globale (approche One Health) et d’objectifs de développement durable (ODD). Tant que l’élevage commercial d’animaux sauvages reste toléré, ces engagements restent des promesses non tenues.
Protéger les animaux, c’est protéger leur habitat
Il est temps de tourner la page de cette industrie opaque et destructrice.
Chez Code Animal, nous défendons une évidence : la protection des animaux sauvages ne peut se faire qu’en protégeant leurs milieux de vie et les écosystèmes dont ils font partie.
Un tigre n’a rien à faire dans une cage. Un perroquet n’a rien à faire dans un entrepôt.
Protégeons-les là où ils doivent vivre : dans la nature.
Oriane Santhasouk-Erb

Source : Unsplash
Green, J., Schmidt-Burbach, J., & Elwin, A. (2023). Taking stock of wildlife farming: A global perspective. Global Ecology and Conservation, 42 https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e0245