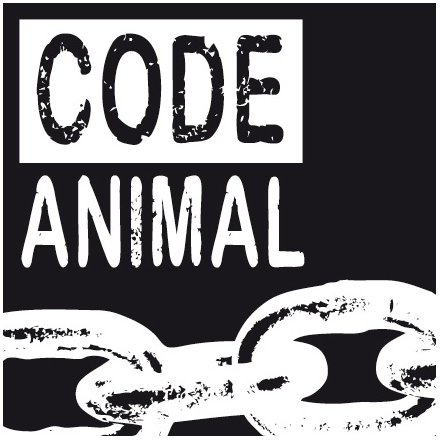Une image trompeuse de la biodiversité à sauver
Quand on pense « conservation des espèces », ce sont souvent les mêmes animaux qui s’imposent : un éléphant d’Afrique, un tigre du Bengale, un ours polaire ou un panda géant. Ces animaux sont devenus de véritables symboles de la conservation. Ils occupent les campagnes de sensibilisation, les affiches des ONG, les pages des manuels scolaires… et ils captent aussi, sans surprise, la grande majorité des financements.
Mais derrière cette vitrine se cache une réalité beaucoup plus déséquilibrée : la conservation est largement biaisée en faveur des espèces dites “charismatiques”, souvent au détriment de celles qui sont réellement les plus en danger.

Image générée par IA
Ce que montre la recherche
Une vaste étude menée par l’Université de Hong Kong a analysé près de 14 600 projets de conservation financés entre 1992 et 2016, représentant près de 2 milliards de dollars. Les résultats sont sans appel :
- 82,9 % des financements ont été alloués aux vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons), qui ne représentent pourtant qu’une infime partie de la biodiversité connue.
- Les plantes et les invertébrés, pourtant essentiels aux écosystèmes, n’ont reçu que 6,6 % des fonds chacun.
- Les champignons et les algues ont été presque totalement oubliés, avec moins de 0,2 % du budget global.
Même au sein des vertébrés, les déséquilibres persistent :
- Les grands mammifères (éléphants, rhinocéros, félins, primates) concentrent l’essentiel de l’attention.
- À l’inverse, les amphibiens, pourtant le groupe le plus menacé, n’ont reçu que 2,8 % des financements.
- Chez les reptiles, 91 % des fonds vont aux tortues, laissant très peu de ressources pour les serpents, les lézards ou les crocodiles.
Et ce n’est pas parce que ces espèces sont les plus en danger. 94 % des espèces menacées identifiées dans l’étude n’ont reçu aucun soutien financier. En revanche, plus de 500 projets ont été consacrés à des espèces comme le loup gris ou l’ours brun, tous deux classés en « préoccupation mineure » par l’UICN.

Photo credit : Unsplash
Pourquoi ce biais existe-t-il ?
La réponse est simple : l’émotion, l’image, la culture. Les espèces les plus financées sont souvent celles qui :
- Ont un grand corps, une allure majestueuse ou impressionnante
- Sont perçues comme intelligentes, proches de l’humain ou photogéniques
- Sont déjà populaires dans les médias ou la culture (films, publicités, symboles nationaux)
Ce sont les “flagship species”, qui peut se traduire en français par « espèce emblématique » ou « espèce porte-drapeau ». Ce sont “celles que l’on choisit pour « faire passer le message ».
Et effectivement, elles attirent l’attention du public et facilitent les levées de fonds.
Mais ce modèle pose deux problèmes majeurs :
- Il fausse les priorités. Les espèces les plus menacées ne sont pas forcément les plus visibles ou les plus aimées.
- Il oublie l’écosystème. Protéger un animal sans s’occuper de son habitat ou des espèces qui l’entourent, c’est agir à moitié.

Photo credit : Unsplash
Ce que ça change concrètement
Le déséquilibre des financements n’est pas juste un problème moral. Il rend la conservation moins efficace.
Les chercheur·ses ont constaté qu’il n’y a pas de lien clair entre le montant investi et l’amélioration de la population d’une espèce. En d’autres termes : dépenser beaucoup pour une espèce “star” ne garantit pas qu’elle ira mieux.
À l’inverse, les espèces négligées (comme de nombreux insectes, petits mammifères, amphibiens ou plantes rares) jouent souvent un rôle clé dans le bon fonctionnement des écosystèmes.
Les ignorer, c’est risquer l’effondrement de tout un équilibre.
Comment rééquilibrer les priorités ?
1. Prendre en compte la menace réelle
L’UICN fournit une évaluation rigoureuse du risque d’extinction des espèces. S’appuyer sur ces données, plutôt que sur la popularité, permettrait de répartir les ressources de manière plus juste.
Aujourd’hui, près de 30 % des fonds sont alloués à des espèces non menacées.
2. Soutenir les espèces et groupes négligés
Les invertébrés, les champignons, les plantes et les petits vertébrés (comme les rongeurs ou les chauves-souris) sont massivement sous-financés. Pourtant, ils sont indispensables pour le recyclage des sols, la pollinisation, la régulation des populations, le stockage du carbone, entre autres !
Leur protection bénéficierait à tout l’écosystème, et donc aussi aux espèces plus visibles.
3. Valoriser les approches écosystémiques
Plus de la moitié des projets étudiés étaient centrés sur une seule espèce. Or, protéger une espèce sans agir sur son habitat, ses interactions, son réseau écologique, a peu de chances de fonctionner.
Des projets plus globaux, même avec moins d’argent par espèce, peuvent préserver un ensemble de biodiversité.
4. Mieux coordonner et mieux suivre les efforts
Les chercheur·ses recommandent :
- Une base de données mondiale sur les financements
- Plus de transparence sur les choix d’allocation
- Moins de doublons entre projets qui soutiennent déjà des espèces bien financées
Cela permettrait de mieux répartir les moyens disponibles, sans les gaspiller.

Photo credit : Unsplash
Changer notre regard pour changer la conservation
Il ne s’agit pas de dire que les éléphants ou les pandas ne doiventpas être protégés. Ils le doivent, mais ils ne sont pas les seuls.
La biodiversité ne se résume pas à une galerie de jolis portraits. C’est un tissu vivant, complexe, où chaque espèce, même minuscule ou méconnue, a un rôle à jouer. C’est précisément due à cette complexité que seule la conservation in situ, c’est-à-dire des programmes de conservation dans l’habitat naturel de l’espèce concernée, peut préserver efficacement les animaux sauvages de l’extinction.
Changer notre manière de voir, de raconter, de financer la conservation, c’est l’un des leviers les plus puissants pour éviter de perdre ce qui fait la richesse du vivant ! Code Animal milite ainsi pour que toutes les espèces menacées, iconiques ou mal-aimées du public, soient équitablement incluses dans des programmes de conservation in situ, loin de l’industrie de la captivité qui n’hésite pas à enfermer des animaux sans qu’aucune menace ne pèse sur leur espèce (prenez l’exemple des capybaras, des autruches, etc)
Oriane Santhasouk-Erb

Photo credit : Unsplash
SOURCES
Bailey Kim, A. (2025, 16 juillet). You win some, you lose many: Conservation bias fails the most vulnerable. Faunalytics. Récupéré de https://faunalytics.org/you-win-some-you-lose-many-conservation-bias-fails-the-most-vulnerable/ Faunalytics
DTE Staff. (2025, 26 février). Wildlife conservation funds biased against smaller species as larger animals take lion’s share: Study. Down To Earth. Récupéré de https://www.downtoearth.org.in/wildlife-biodiversity/wildlife-conservation-funds-biased-against-smaller-species-as-larger-animals-take-lions-share-study Down To Earth
Khatiwada, G. (2025, 4 mars). Conservation funding bias endangers lesser-known species: Study. Ecosphere News. Récupéré de https://www.ecospherenews.com/detail/533 ecospherenews.com