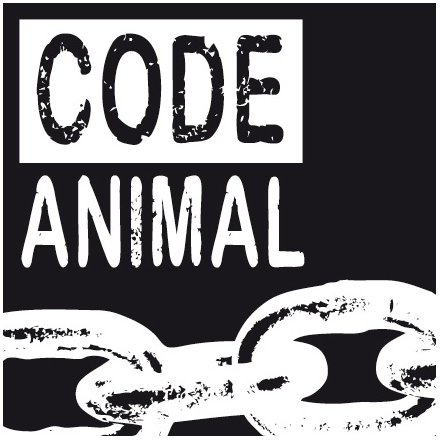Pourquoi parler de sentience chez les invertébrés ?
Quand on parle d’animaux « sensibles », on pense tout de suite aux mammifères, parfois aux oiseaux, plus rarement aux poissons. Mais les invertébrés ? Très peu de personnes se posent la question.
Et pourtant, les invertébrés représentent 97 % des espèces animales sur Terre. On les retrouve partout : dans les océans, les forêts, les campagnes… mais aussi dans les aquariums, les cirques ou dans nos maisons en tant que « nouveaux animaux de compagnie » (comme les phasmes, les mygales, les bernards-l’hermite ou encore certaines espèces de pieuvres).

Malgré leur omniprésence, ils sont largement absents des lois de protection animale. En France, seuls les vertébrés sont officiellement reconnus comme êtres sensibles dans le Code rural. Quelques pays, comme le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande, ont récemment commencé à intégrer certains invertébrés à leur législation, mais cela reste l’exception.
Alors pourquoi ce vide ? Par méconnaissance, par habitude, et parfois parce qu’ils nous sont trop différents. Leur apparence, leur biologie, leur façon d’interagir avec leur environnement ne nous ressemblent pas. Et ce qui ne nous ressemble pas… on a parfois du mal à s’en soucier.
C’est quoi, exactement, la sentience ?
La sentience, c’est la capacité à ressentir consciemment des expériences positives ou négatives : la douleur, le plaisir, la faim, la peur, le confort… Ce n’est pas simplement réagir à un stimulus, c’est ressentir quelque chose intérieurement.
Un être sentient n’est pas juste un organisme vivant. C’est un être qui fait l’expérience de sa vie.
Pendant longtemps, on a supposé que seuls les animaux dotés d’un cerveau complexe (comme les mammifères) pouvaient être sentients. Puis les recherches ont montré que les oiseaux, les poissons, et même certains insectes avaient des comportements bien plus élaborés qu’on ne le croyait.
Aujourd’hui, la question de la sentience chez les invertébrés n’est plus marginale, mais un champ de recherche actif.
Ce que dit la science : des invertébrés loin d’être « insensibles »
Les études scientifiques se multiplient, et plusieurs groupes d’invertébrés retiennent particulièrement l’attention.
-
Les pieuvres
Le cas des pieuvres est emblématique. Ces animaux marins sont capables de :
- Résoudre des problèmes complexes (ouvrir un bocal fermé, déplacer un objet pour atteindre de la nourriture)
- Se souvenir d’événements passés (reconnaître une personne qui les a nourries ou stressées, et modifier leur comportement à son approche)
- Apprendre par observation (regarder une autre pieuvre résoudre un problème, puis reproduire la solution)
- Montrer des préférences individuelles (certaines pieuvres préfèrent interagir avec certains objets ou évitent certaines cachettes)
Leur système nerveux, réparti entre un cerveau central et des ganglions dans les bras, est très différent du nôtre, mais tout aussi performant. Le film My Octopus Teacher a d’ailleurs sensibilisé un large public à l’intelligence de ces animaux.
-
Les crabes et homards
Des recherches ont montré que les crabes évitent les sources de douleur après une première exposition, qu’ils peuvent se souvenir de leur emplacement, et qu’ils montrent des signes de stress quand ils sont manipulés brutalement. Ils modifient aussi leur comportement pour éviter une expérience désagréable à l’avenir.
-
Les seiches
Elles aussi font preuve d’un comportement étonnant. Dans des expériences, elles ont montré qu’elles pouvaient attendre un aliment plus appétissant plutôt que de manger immédiatement celui qu’on leur propose. C’est le même principe que le célèbre « test du marshmallow » chez les enfants : un enfant placé devant une guimauve peut choisir de ne pas la manger tout de suite s’il sait qu’il en obtiendra deux plus tard. Ce type d’auto-contrôle est rare chez les animaux.
Les seiches montrent également des signes d’apprentissage social : elles sont capables d’observer le comportement d’un congénère et de s’en inspirer pour résoudre un problème, sans l’avoir vécu directement elles-mêmes.
Pourquoi c’est crucial de les prendre en compte ?
Reconnaître la sentience des invertébrés, ce n’est pas un luxe ou une lubie intellectuelle. C’est un changement de regard nécessaire.
Aujourd’hui, la souffrance animale est de plus en plus prise en compte dans nos sociétés. Mais elle repose encore souvent sur une hiérarchie implicite : plus un animal nous ressemble, plus on s’inquiète de son bien-être. Et les invertébrés se retrouvent ainsi quasiment exclus de la réflexion éthique.
Résultat :
- Ils sont très peu protégés par la loi, sauf quelques exceptions
- Ils sont souvent maltraités sans que cela ne fasse débat (transport sans eau, manipulation à la main dans les aquariums, élevage dans des conditions pauvres)
- Ils sont absents de la majorité des grilles d’évaluation du bien-être animal utilisées dans les zoos et aquariums
Si l’on veut défendre le respect de tous les êtres vivants capables de ressentir, il est logique et cohérent d’intégrer les invertébrés à cette réflexion.
Alors, on fait quoi maintenant ?
1. Mieux comprendre pour mieux agir
Il faut approfondir nos connaissances : quels sont leurs besoins ? Leurs comportements naturels ? Comment détecter leur stress ou leur inconfort ?
Cela passe par des études scientifiques, mais aussi par le partage de ces connaissances entre chercheur·ses, soignant·es, vétérinaires et aquaristes.
2. Créer des repères clairs pour les structures
Aujourd’hui, il existe très peu de recommandations pratiques pour les invertébrés. Les grandes associations zoologiques européennes comme l’EAZA (Association européenne des zoos et aquariums), l’AZA (Amérique du Nord) ou la BIAZA (Royaume-Uni) publient des documents appelés guidelines : ce sont des fiches qui décrivent les bonnes pratiques pour détenir une espèce en captivité (bien que détenir un animal sauvage captif ne peut sous aucune condition permettre son bien-être).
Problème : les invertébrés sont très peu concernés. Par exemple, l’EAZA ne propose aucun guide pour les invertébrés aquatiques, alors qu’ils sont présents dans presque tous les aquariums.
3. Outiller et former les équipes
La conservation des espèces ne peut se faire que dans leur milieu naturel, et les invertébrés ne font pas exception à cette règle. La détention de ces espèces en captivité, non seulement inefficace, génère aussi de la souffrance. Cependant, une première étape transitoire serait de permettre aux équipes en charge des invertébrés captifs de se former, dans l’objectif de réduire leur mal-être. Bonne nouvelle : dans de nombreuses structures, les personnes en charge des invertébrés ont une solide formation. Une enquête indique que 88 % des aquaristes américains ont un diplôme équivalent à Bac +3 ou plus.
Cela signifie qu’on peut leur proposer des outils avancés comme l’AWAG (Animal Welfare Assessment Grid), qui permet de suivre dans le temps l’état de santé et de bien-être d’un animal. Cet outil a déjà été testé avec succès sur les céphalopodes et les crustacés.
4. Faire évoluer la loi
En 2022, le Royaume-Uni a reconnu la sentience des pieuvres, seiches, crabes et homards. Cette avancée permet notamment :
- D’interdire certaines pratiques (comme la cuisson à vif)
- D’encadrer le transport ou l’élevage de ces espèces
- D’intégrer leur bien-être aux politiques publiques
Rien n’empêche la France de s’inspirer de cette démarche.
5. Changer notre regard, tout simplement
Enfin, il faut aider les personnes à voir les invertébrés autrement. Non, ce ne sont pas des créatures insignifiantes ou interchangeables. Ce sont des êtres complexes, souvent fascinants, qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes.
Les faire découvrir autrement (expositions, vidéos, contenus éducatifs) peut susciter curiosité, respect et émerveillement.
Oriane Santhasouk-Erb