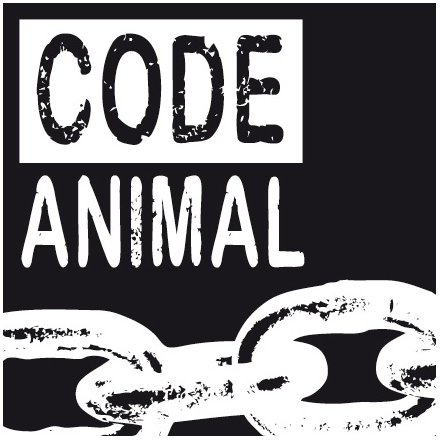Le 8 juillet 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi dite « Duplomb », du nom du sénateur Laurent Duplomb, rapporteur du texte. Présentée comme un allègement des contraintes pesant sur les agriculteurs, cette loi suscite une vive inquiétude parmi les associations de protection de l’environnement, les scientifiques, les professionnels de santé publique et une partie du monde politique. Derrière une volonté affichée de « simplification », c’est un véritable démantèlement de plusieurs acquis environnementaux qui s’opère.
Parmi les mesures les plus controversées figure la réintroduction de certains néonicotinoïdes, ces insecticides neurotoxiques pourtant interdits en France depuis 2018 en raison de leur impact dramatique sur les pollinisateurs.
Parmi les mesures les plus controversées figure la réintroduction de certains néonicotinoïdes, ces insecticides neurotoxiques pourtant interdits en France depuis 2018 en raison de leur impact dramatique sur les pollinisateurs. L’acétamipride, encore autorisé dans l’Union européenne, pourrait désormais être de nouveau utilisé en France. La loi prévoit également que d’autres substances similaires comme le sulfoxaflor ou le flupyradifurone pourraient faire l’objet de dérogations, malgré les avertissements répétés de plusieurs agences sanitaires.
Parmi elles :
-
Anses : l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
-
EFSA : l’Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority),
-
IFR : l’Institut francilien d’épidémiologie, de santé publique et de recherche sur les pesticides.
Toutes trois alertent sur les effets délétères de ces substances sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine : perturbations endocriniennes, neurotoxicité, effets potentiellement cancérogènes… Le retour de ces insecticides dits « tueurs d’abeilles » est donc dénoncé comme une grave régression, contraire au principe de non-régression environnementale inscrit dans le Code de l’environnement depuis 2016.

Photo credit : Unsplash
Autre disposition vivement critiquée : la suppression de la séparation entre le conseil agricole et la vente de produits phytosanitaires. Jusqu’ici, un exploitant agricole ne pouvait être conseillé que par un professionnel indépendant de tout intérêt commercial dans la vente de pesticides. En supprimant cette séparation, la loi ouvre la voie à des conflits d’intérêts, risquant de renforcer une dépendance structurelle de l’agriculture française aux produits chimiques, au détriment de la transition agroécologique.
Le texte facilite par ailleurs l’agrandissement des élevages industriels, en relevant les seuils déclenchant une évaluation environnementale. Autrement dit, des bâtiments d’élevage accueillant des milliers d’animaux supplémentaires pourront désormais être construits sans véritable étude d’impact. Cette dérégulation intervient alors que les méfaits des élevages intensifs sur le bien-être animal, les ressources en eau, la pollution de l’air ou encore la santé publique sont de plus en plus dénoncés.
L’autre mesure symbolique de cette loi concerne les mégabassines, ces réserves artificielles d’eau destinées à l’irrigation de cultures agricoles intensives. Désormais reconnues comme des « projets d’intérêt général majeur », ces installations bénéficieront de procédures accélérées et seront mieux protégées contre les recours juridiques. Pourtant, de nombreuses études scientifiques et mobilisations citoyennes soulignent leur inefficacité face au changement climatique et leur impact sur le cycle naturel de l’eau et les nappes phréatiques.

Photo credit : Unsplash
Enfin, la loi porte un coup sérieux à l’indépendance des contrôles environnementaux en modifiant le fonctionnement de l’Office français de la biodiversité (OFB). Jusqu’à présent, les inspecteurs de l’environnement, agents assermentés de l’OFB, bénéficiaient d’une relative autonomie dans leurs missions de police de la nature. Ils pouvaient contrôler les infractions liées à la faune, à la flore, aux milieux naturels ou à l’usage des produits phytosanitaires en toute indépendance, selon des priorités définies au niveau national ou en fonction des enjeux locaux.
Avec cette nouvelle loi, les agents de l’OFB se retrouvent placés sous l’autorité directe des préfets pour l’organisation de leurs contrôles. Ce changement n’est pas anodin : les préfets, représentants de l’État dans les départements, sont soumis à des pressions politiques et économiques locales, notamment dans les territoires fortement marqués par l’agriculture intensive. En leur conférant le pouvoir de prioriser, voire de freiner certaines missions de contrôle, la loi crée un risque évident d’entrave ou de limitation des inspections environnementales dans les zones les plus sensibles.
Ce glissement remet en question la capacité de l’OFB à exercer sa mission de manière impartiale et efficace, en particulier lorsqu’il s’agit de sanctionner des pratiques agricoles illégales : destructions d’habitats, usage de pesticides interdits, arrachage de haies, dérangement d’espèces protégées, ou pompages excessifs dans les nappes phréatiques. Dans un contexte où les conflits entre certains syndicats agricoles et les agents de l’OFB se sont déjà multipliés ces dernières années, ce transfert de pouvoir vers les préfets apparaît comme une forme de désaveu institutionnel, susceptible de fragiliser encore davantage l’autorité des inspecteurs de l’environnement sur le terrain.

Crédit photo : Philippe Massit / OFB (site)
Face à ce texte, les réactions ont été aussi immédiates que nombreuses, témoignant de l’ampleur de l’inquiétude qu’il suscite au sein de la société française. Sur le plan institutionnel, plusieurs groupes parlementaires de l’opposition – dont les écologistes, les socialistes, la France insoumise et les communistes – ont saisi le Conseil constitutionnel dès le 11 juillet 2025. Ils estiment que plusieurs dispositions de la loi sont contraires à des principes fondamentaux du droit français, en particulier ceux issus de la Charte de l’environnement, qui fait partie intégrante de notre bloc de constitutionnalité depuis 2005.
Le principal grief invoqué concerne le principe de non-régression environnementale, inscrit dans le Code de l’environnement depuis 2016. Ce principe interdit que la législation en matière de protection de l’environnement régresse, sauf à justifier cette régression de manière rigoureuse. Or, les parlementaires estiment que la réintroduction des néonicotinoïdes, même sous forme de dérogation, constitue une telle régression, d’autant plus qu’aucune évaluation indépendante n’a démontré l’absence d’alternatives viables à ces substances.
Le recours pointe également une atteinte au principe de précaution, défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Selon les députés requérants, permettre la mise sur le marché de substances controversées, sans garanties suffisantes ni définition claire des conditions de leur usage, revient à ignorer les risques graves et irréversibles que ces produits peuvent faire peser sur la biodiversité et la santé humaine.

Photo credit : Unsplash
Un autre argument central du recours concerne le droit fondamental à vivre dans un environnement sain et équilibré, énoncé à l’article 1er de la Charte. En affaiblissant les procédures de contrôle, en facilitant l’expansion des élevages industriels et en restreignant les possibilités de recours contre les projets de mégabassines, la loi compromettrait directement ce droit constitutionnellement garanti.
Enfin, les parlementaires dénoncent une adoption précipitée du texte, sans réel débat parlementaire. L’utilisation d’une motion de rejet préalable à l’Assemblée nationale a en effet conduit à évacuer l’examen des articles en séance, privant les députés d’un débat démocratique approfondi. Selon les signataires du recours, cette procédure accélérée constitue un vice de forme qui fragilise la légitimité même du vote.
Saisi en amont de la promulgation, le Conseil constitutionnel dispose d’un mois pour rendre sa décision. Il pourra censurer tout ou partie de la loi, formuler des réserves d’interprétation, ou renvoyer certaines dispositions au législateur pour modification. Sa décision est attendue avec une grande attention, tant elle pourrait conditionner la portée réelle de la loi Duplomb. Elle constituera un véritable test pour la protection juridique de l’environnement en France, à un moment où les enjeux écologiques n’ont jamais été aussi cruciaux.

Photo credit : Unsplash
Parallèlement à ces démarches institutionnelles, la société civile s’est mobilisée massivement contre la loi. Une pétition en ligne, hébergée sur le site de l’Assemblée nationale dans le cadre du dispositif officiel de « pétition citoyenne », a recueilli plus d’un million de signatures en seulement quelques jours, un chiffre inédit sous ce quinquennat.
Cette mobilisation rapide et massive traduit une forte inquiétude de la population face à ce qui est perçu comme une déréglementation environnementale majeure, contraire à l’intérêt général. Conformément à l’article 147‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, toute pétition dépassant le seuil des 100 000 signataires doit être examinée en Conférence des présidents.
Cette dernière peut alors décider de la transmettre à la commission compétente — en l’occurrence, la Commission du développement durable — qui peut à son tour organiser une audition publique, voire proposer l’inscription à l’ordre du jour. Si la procédure est encore peu utilisée et reste largement consultative, elle ouvre néanmoins la voie à une forme d’interpellation directe du pouvoir législatif par les citoyennes et citoyens.
Si cette procédure reste consultative et n’a pas de valeur contraignante, elle ouvre néanmoins la possibilité d’un débat parlementaire dédié. Ce processus permettrait de remettre la question environnementale au centre des discussions et de faire entendre les arguments scientifiques, juridiques et citoyens trop peu présents lors de l’examen précipité de la loi. Cette dynamique pourrait également exercer une pression politique accrue sur le gouvernement et nourrir les réflexions en vue d’une éventuelle proposition de loi rectificative, notamment si le Conseil constitutionnel venait à censurer certaines dispositions.

Photo credit : Unsplash
La loi Duplomb, adoptée dans un climat de tension entre exigences productivistes et impératifs écologiques, représente un tournant préoccupant pour la protection de l’environnement en France. Derrière la promesse d’un allègement des contraintes pesant sur le monde agricole, ce texte opère un recul net sur plusieurs principes fondamentaux du droit de l’environnement : indépendance des contrôles, usage des substances toxiques, encadrement des projets à fort impact écologique, droit à l’information et à la participation du public.
Alors que les alertes scientifiques et les signaux d’alarme sur l’état de la biodiversité se multiplient, affaiblir les garde-fous environnementaux apparaît non seulement contre-productif, mais aussi dangereux pour les générations futures. La réponse institutionnelle – saisines du Conseil constitutionnel – et la mobilisation citoyenne massive autour de la pétition témoignent d’une prise de conscience profonde de ces enjeux dans la société française.
Les semaines à venir seront décisives. La décision du Conseil constitutionnel, l’éventuelle audition parlementaire des pétitionnaires, ou encore la pression sociale maintenue sur les élus pourraient redessiner le destin de cette loi controversée. Plus largement, ce débat remet en lumière la nécessité de renforcer les mécanismes de vigilance démocratique face aux reculs environnementaux. Car si l’écologie n’a pas encore pleinement conquis les textes législatifs, elle s’impose de plus en plus dans les consciences. Et c’est peut-être là que commence le changement.

Photo credit : Unsplash
Sources
Gossement Avocats. (2025). Loi Duplomb : un stress-test pour la Charte de l’environnement. Consulté sur https://www.gossement-avocats.com/blog/loi-duplomb-un-stress-test-pour-la-charte-de-lenvironnement-loi-visant-a-lever-les-contraintes-a-lexercice-du-metier-dagriculteur/
Gossement Avocats. (2025). Le principe de non-régression du droit de l’environnement est inscrit dans le Code de l’environnement. Consulté sur https://www.gossement-avocats.com/blog/le-principe-de-non-regression-du-droit-de-l-environnement-est-inscrit-dans-le-code-de-l-environnement/
LCP. (2025, juillet 11). Loi agricole Duplomb : la gauche saisit le Conseil constitutionnel. Consulté sur https://lcp.fr/actualites/loi-agricole-duplomb-la-gauche-saisit-le-conseil-constitutionnel-387979
La Dépêche. (2025, juillet 9). Loi Duplomb : “trumpiste”, “mortifère”, “écocide”… Après l’adoption du texte décrié, quels recours possibles pour empêcher son application ? Consulté sur https://www.ladepeche.fr/2025/07/09/loi-duplomb-trumpiste-mortifere-ecocide-apres-ladoption-du-texte-decrie-quels-recours-possibles-pour-empecher-son-application-12815642.php
L’Info Durable. (2025). Loi Duplomb : un million de signatures, et après ?. Consulté sur https://www.linfodurable.fr/politique/loi-duplomb-un-million-de-signatures-et-apres-52219
Wikipédia. (2025). Conseil constitutionnel (France). Consulté sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_%28France%29