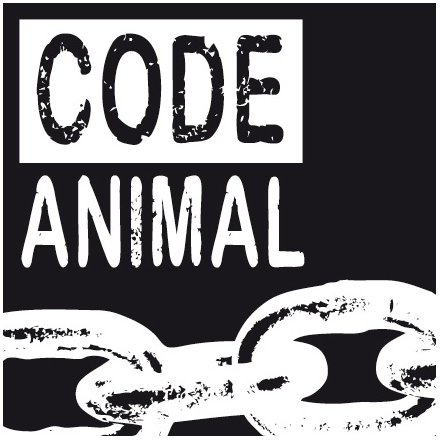Le commerce d’espèces sauvages ne rime pas toujours avec illégalité.
Contrairement au trafic faunique illégal qui génère environ 7 à 23 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an, le commerce licite de végétaux et d’animaux sauvages est encadré par une convention internationale : la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite Convention de Washington (« CITIES »).
Cette convention a été créée dans le but de concilier deux objectifs distincts : d’un côté la vente d’espèce sauvages sollicitée par les zoos, la recherche, la mode, la pêche, et d’un autre côté la préservation de la biodiversité.
Si ces objectifs semblent divergents, c’est parce que la surexploitation d’espèces sauvages constitue l’une des causes majeures de disparition de la biodiversité, et ce à l’échelle internationale.
Il était donc primordial que les États coopèrent entre eux pour s’accorder sur une règlementation commune du commerce.
Dans cet esprit, la CITES a été conclue le 3 mars 1973 pour une entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1975. Elle s’applique dans les 184 pays l’ayant approuvé, dont la France depuis 1978.

Un commerce encadré à l’échelle mondiale
La CITES confère une protection à plus de 40 000 espèces sauvages, végétales ou animales, répertoriées dans ses trois annexes.
L’objectif de la CITES est de garantir que le commerce international des espèces sauvages ou de leurs produits dérivés ne nuise ni à la conservation, ni à la durabilité de la biodiversité.
Ainsi, le degré de protection accordé aux espèces est graduel en fonction des annexes, allant de l’interdiction du commerce à sa réglementation par des formalités administratives obligatoires :
-
L’annexe I liste les animaux en voie de disparition : la vente et le prélèvement sont alors interdits, sauf lorsque l’importation n’est pas faite à des fins commerciales (éducation, formation, recherche scientifique, conservation des espèces), auquel cas celle-ci sera conditionnée à la détention d’un permis d’importation et d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation.
-
L’annexe II concerne les animaux dont la vente pourrait présenter une menace pour la survie ou le développement de leur population si le commerce n’était pas étroitement contrôlé, ce qui représente 96 % des espèces répertoriées.
La vente est soumise à la détention d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation délivré par les autorités nationales, après un avis scientifique attestant que le mode d’obtention n’est pas préjudiciable à l’espèce. -
L’annexe III classe les espèces inscrites à la demande spécifique d’un pays signataire de la convention, qui en réglemente déjà le commerce : la vente est conditionnée à la possession d’un seul permis d’exportation provenant du pays ayant inscrit l’espèce ou d’un certificat d’origine d’un pays n’ayant pas inscrit l’espèce.
Ainsi, tout pays peut demander l’ajout ou la suppression d’une espèce en annexe III, alors que les espèces répertoriées en annexes I ou II ne peuvent être ajoutées ou retirées que par la Conférence des Parties signataires, lors de sessions organisées tous les deux à trois ans.

photo credit : Unsplash
Alors que le respect de cette réglementation est favorisé par le contrôle des douanes, il en allait autrement au sein de l’Union européenne, où le marché unique permettait une libre circulation des espèces entre les États sans contrôle systématique.
C’est pour cette raison que l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, en date du 9 décembre 1996, puis d’autres règlements successifs, afin de faire appliquer la CITES de manière harmonisée par ses États membres.
La réglementation européenne confère même une protection accrue à la faune, puisqu’elle reprend les classes d’espèces de la CITES tout en élargissant leur champ d’application :
-
L’annexe A (protection des animaux en voie de disparition) regroupe les espèces de l’annexe I, mais également certaines espèces des annexes II et III auxquelles l’Union européenne souhaite conférer un statut de protection plus élevé, ainsi que des espèces non inscrites à la CITES, comme certaines espèces autochtones protégées par les directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ».
-
L’annexe B (protection des animaux menacés) répertorie les espèces de l’annexe II qui ne figurent pas à l’annexe A, ainsi que quelques espèces de l’annexe III ou non inscrites à la CITES.
-
L’annexe C (protection des animaux classés sur demande des États) reprend les espèces de l’annexe III qui ne sont inscrites ni à l’annexe A, ni à l’annexe B.
-
La réglementation comprend également une annexe D, constituée d’espèces non inscrites à la CITES, mais dont l’Union européenne estime que les volumes d’importation justifient une mise sous surveillance.

Photo credit : Unsplash
L’Union européenne affirme ainsi sa volonté de protéger la biodiversité, et l’a confirmé en devenant elle-même partie à la CITES en 2015.
En France, une réglementation du commerce de la faune sauvage existait déjà avant l’application de la CITES, avec la loi sur la protection de la nature adoptée le 10 juillet 1976.
Il était donc logique que la France ratifie la CITES en 1978.
La loi française, modifiée à plusieurs reprises, interdit la chasse, la destruction, le prélèvement, la naturalisation, le transport, la commercialisation et la détention des espèces sauvages dites « protégées », et sanctionne également la dégradation ou la destruction de leur habitat naturel.
Elle se révèle plus protectrice que la réglementation européenne et internationale sur certains aspects — en interdisant par exemple la commercialisation des passereaux, des castors ou des hérissons —, mais aussi moins contraignante sur d’autres, comme en autorisant la vente du mouflon d’Europe, pourtant classé à l’annexe II de la CITES.

Photo credit : Unsplash
Une réglementation lacunaire
Bien que le commerce licite d’espèces sauvages soit encadré à l’échelle internationale, la réglementation de la CITES présente des lacunes.
La convention n’a aucune influence sur le commerce des espèces non répertoriées.
Si elle protège environ 40 000 espèces sauvages, ce chiffre paraît dérisoire comparé aux quelque 2 millions d’espèces animales et végétales recensées dans le monde.
Or, de nombreuses espèces non protégées font bel et bien l’objet d’un commerce, mais sans contrôle, ou avec un contrôle ponctuel dans certains pays seulement.
Des animaux normalement invendables sont exportés légalement grâce à plusieurs failles de la réglementation.
C’est notamment le cas des spécimens classés en annexe I dits « pré-convention », c’est-à-dire acquis par un État avant que la CITES ne devienne applicable pour la première fois à l’espèce concernée.
Cette stratégie est notamment utilisée par la Chine, qui invoque l’existence d’un « stock légal pré-convention » pour justifier la vente de pangolins (classés en annexe I), alors même que le nombre de pangolins acquis légalement avant l’entrée en vigueur de la CITES ne peut être illimité.
Cette faille est particulièrement dangereuse, car elle permet de blanchir des animaux capturés illégalement, en les réintroduisant sur des marchés légitimes, contribuant ainsi au commerce illicite de la faune sauvage.
Par ailleurs, la CITES ne prévoit aucune disposition visant à contrôler ou à améliorer les conditions de capture, de détention et de transport des animaux vendus légalement.
De même que la quantité d’espèces commercialisées doit être contrôlée pour éviter la surexploitation de la biodiversité, les méthodes de commercialisation devraient l’être également, afin de limiter la souffrance des animaux.
Enfin, en ce qui concerne le contrôle de l’application de la CITES, tout problème constaté dans un État signataire est porté à la connaissance du secrétariat de la CITES, qui en informe alors l’État concerné afin qu’il y remédie.

Photo credit : Unsplash
Or, ce moyen de contrôle reste très limité.
Quand bien même il donnerait lieu à une enquête, seul l’État est responsable :
-
des mesures de surveillance mises en place sur son territoire,
-
des renseignements qu’il accepte de fournir au secrétariat de la CITES,
-
et des mesures correctives qu’il propose à la Conférence des Parties.
Aucun véritable contrôle externe des dispositifs de surveillance ni de sanction n’est prévu en cas de manque de coopération de l’État concerné.
L’impact du commerce légal sur la biodiversité est par ailleurs mal identifié, car les estimations du nombre d’espèces présentes sur le marché sont très largement sous-évaluées.
À ce jour, seuls les États-Unis publient leurs chiffres, qui s’élèvent à 2,85 milliards d’animaux importés en 22 ans de surveillance, selon le docteur Alice Hughes, coautrice d’une étude publiée le 7 janvier 2025 dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
S’il existe un système similaire en Europe, les données ne sont pas rendues publiques, et le niveau de précision par espèce varie fortement d’un pays à l’autre.
Mais à quoi bon encadrer la vente d’espèces sauvages dans un objectif de préservation de la biodiversité si l’on ne dispose pas des données nécessaires pour évaluer les effets de la réglementation et identifier les axes d’amélioration ?
En l’absence de données globales et harmonisées sur l’ensemble des espèces commercialisées, il est impossible d’estimer avec précision l’impact réel du commerce sur les populations sauvages.
Il semble donc nécessaire d’instaurer un système international d’échange et de comparaison des informations relatives à la vente d’espèces sauvages, comme le suggère le docteur Alice Hughes.
Si cela peut paraître laborieux, il convient de rappeler que la plupart des pays disposent déjà de systèmes de surveillance pour des raisons sanitaires.
En effet, le commerce d’espèces sauvages représente également un enjeu majeur de santé publique, en raison des risques liés aux maladies et parasites transmis par les animaux vivants ou leurs produits dérivés utilisés comme remèdes ou aliments traditionnels.
La pandémie de COVID-19 en est une illustration : si l’origine exacte du virus reste incertaine, la piste du gibier de brousse est systématiquement explorée pour chaque nouveau pathogène lié à la maladie.
Il serait donc pertinent de faire évoluer ces systèmes de surveillance sanitaire afin qu’ils servent aussi à préserver la biodiversité.

Photo credit : Unsplash
En définitive, si la CITES et la réglementation européenne ont permis d’instaurer un cadre de contrôle du commerce légal d’espèces sauvages, celui-ci demeure insuffisant à plusieurs égards : trop d’espèces échappent encore à toute protection, les données sont fragmentaires, les contrôles inégalement appliqués, et les sanctions quasi inexistantes en cas de non-coopération d’un État.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable :
-
D’élargir la couverture taxonomique de la CITES, en intégrant davantage d’espèces menacées par le commerce, notamment celles aujourd’hui absentes des annexes malgré des signes de déclin.
-
De créer une base de données publique, centralisée et harmonisée, accessible à l’échelle mondiale, recensant toutes les espèces vendues légalement avec leur provenance, leur destination, et les quantités échangées.
-
De conditionner le commerce légal au respect de normes minimales en matière de bien-être animal, incluant des standards internationaux sur la capture, le transport et la détention.
-
De renforcer les mécanismes de contrôle de la CITES, en prévoyant des audits indépendants, un accès élargi aux données des États, et des sanctions effectives en cas de manquements persistants.
-
D’articuler la protection de la biodiversité et la prévention des risques sanitaires, en intégrant les échanges fauniques dans les dispositifs de surveillance épidémiologique existants.
Ces améliorations sont indispensables pour faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur la faune sauvage et garantir que le commerce ne continue pas à alimenter la perte de biodiversité ou de nouveaux risques sanitaires globaux.
Axelle Lesseur, Avocate

Photo credit : Unsplash
Image illustration générée par IA
Sources
-
GEO. (s.d.). Pas si simple : l’épineux problème du commerce légal d’animaux sauvages. GEO. https://www.geo.fr/animaux/pas-si-simple-l-epineux-probleme-du-commerce-legal-d-animaux-sauvages-224692
-
Ministère de la Transition Écologique. (s.d.). Commerce international des espèces sauvages (CITES). https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/commerce-international-especes-sauvages-cites
-
Office Français de la Biodiversité (OFB). (s.d.). La convention sur le commerce international des espèces sauvages. https://www.ofb.gouv.fr/la-convention-sur-le-commerce-international-des-especes-sauvages
-
CITES. (s.d.). Annexes I, II et III. https://cites.org/fra/app/index.php
-
Ministère de la Transition Écologique. (2016). Présentation de la réglementation CITES. https://info.cites.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_reglementation_CITES_2016-02-1_cle0847dc.pdf
-
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). (s.d.). Combien y a-t-il d’espèces sur Terre ? https://www.mnhn.fr/fr/combien-y-a-t-il-d-especes-sur-terre
-
CITES (UNIA). (s.d.). CITES Appendices I, II et III – Tableaux explicatifs. https://cites.unia.es/file.php/5/html/appendix.htm
-
Vigne, J.-D. (2014). Commerce et protection des espèces sauvages : les limites de la CITES. Faune Sauvage, 303, 16–21. https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/RevueFS/FauneSauvage303_2014_Art7.pdf